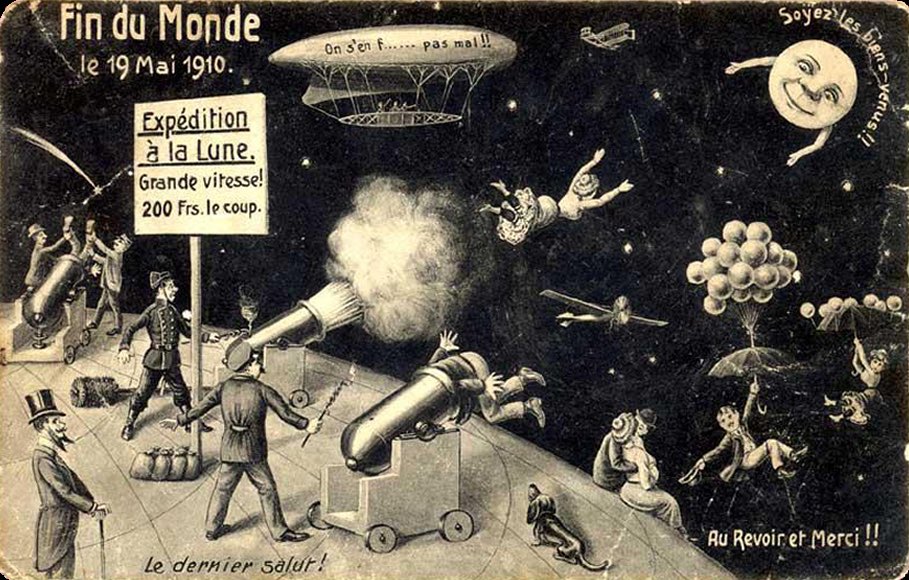De manière inégale aux cours des siècles, les trois monothéismes ont fait d’Israël et de la Palestine un territoire essentialisé. Certains déplorent désormais la persistance d’une vision dépeignant une région « stéréotypée, prisonnière d’un passé jamais révolu ».
Histoire d’une notion.
Faut-il changer de regard sur la Palestine ? C’est ce à quoi nous invite l’exposition de l’Institut du monde arabe, « Ce que la Palestine apporte au monde », dont le terme a été reporté au 31 décembre en raison de sa résonance avec l’actualité. Dans l’une de ses parties au titre évocateur, « Palestine : une Terre sainte ? Une terre habitée ! », le public est ainsi convié, à travers deux séries de photographies, à comparer deux visions.
La première, « nostalgique et orientaliste, véhicule l’image d’une terre mythifiée, stéréotypée » et « faisant de la Palestine une Terre sainte, prisonnière d’un passé jamais révolu, promise à une quête infinie d’une gloire ancienne », résume le texte de présentation. La seconde partie invite, elle, à se défaire de cette image pour prêter attention à ceux qui y habitent et essaient d’en faire un lieu de vie et de culture.
Mais peut-on vraiment désacraliser l’image de la région ? « Je ne le pense pas. La Palestine reste associée à des imaginaires religieux et identitaires depuis des siècles, estime l’historienne Katell Berthelot (Jérusalem. Histoire d’une ville-monde des origines à nos jours, Flammarion, 2016). En revanche, on peut se demander de quel type de sainteté on parle. »
L’histoire de la « Terre sainte » est relatée dans la Bible hébraïque. L’expression précise se trouve dans le livre de Zacharie (2,16), qui désigne Jérusalem et ses environs comme le « domaine » et le « patrimoine » de Dieu « sur la Terre sainte ». « La sainteté biblique reste toutefois très “relationnelle”. C’est parce que Dieu choisit cette terre qu’elle est sainte, ce n’est pas une propriété de la terre en soi », décrypte Katell Berthelot.
Dans le judaïsme, cette nuance aura son importance. Après l’exil suivant la destruction du second Temple de Jérusalem en l’an 70 par les Romains, les rabbins vont certes insister sur l’importance de ce territoire « promis » par Dieu. Mais « pour le judaïsme traditionnel, ce n’est pas aux hommes de décider quand le peuple doit y retourner, c’est à Dieu », poursuit la chercheuse.
Jérusalem céleste
Il faut attendre le Moyen Age et le développement de la Kabbale, courant mystique juif, pour voir se diffuser une « pensée de l’essentialisation de cette terre, qui serait sainte en elle-même, faisant de sa conquête, comme du temps des successeurs de Moïse, un commandement permanent ». « C’est cette pensée qui va fonder l’arrière-plan idéologique du mouvement des colons aujourd’hui en Cisjordanie », selon Katell Berthelot.
Les chrétiens des premiers siècles, quant à eux, ne se sont presque pas préoccupés de la Palestine. La Jérusalem céleste revêt alors davantage d’importance que la terrestre. « Les portes du ciel restent ouvertes aussi bien en Bretagne qu’à Jérusalem », écrit même dans une lettre l’un des pères de l’Eglise, Jérôme de Stridon (347-420). La donne change cependant à partir du IVe siècle et la conversion massive de l’Empire romain. Pendant près de quatre cents ans, les Byzantins vont construire d’innombrables églises et développer des réseaux de pèlerinage sur les lieux supposés de la vie de Jésus.
« Le degré d’importance que les chrétiens accordent à la Terre sainte dépend beaucoup de leur capacité à y aller. Durant les croisades (1095-1291), elle devient centrale. Puis, lorsque les croisés perdent le contrôle, les chrétiens trouvent d’autres lieux de compensation, comme Saint-Jacques de Compostelle, décrypte l’historien au Collège de France Henry Laurens (La Question de Palestine. L’invention de la Terre sainte, Fayard, 2002). A partir du XIXe siècle, avec le déclin de l’Empire ottoman, les chrétiens vont massivement relancer les pèlerinages, investir dans l’archéologie et construire de nouveaux récits autour des lieux présentés comme bibliques. »
Au point que les mouvements sionistes, au tournant du XXe siècle, s’efforceront de « lutter contre une approche christiano-centrée de la Palestine : pour eux, ce n’est pas la Terre sainte mais la terre-patrie, qu’il s’agit de faire passer du registre religieux au registre national », souligne l’historienne Chloé Rosner, dont l’ouvrage Creuser la terre-patrie (CNRS Editions, 336 pages, 26 euros) a été publié en octobre.
Les musulmans vont, au cours des siècles – notamment en réponse aux croisades –, également développer un réseau de pèlerinages dans la région, de l’esplanade des Mosquées à Jérusalem au tombeau des Patriarches à Hébron, en passant par Nabi Moussa (Cisjordanie), abritant la tombe présumée de Moïse, aussi prophète en islam. Aujourd’hui encore, « aux yeux du Hamas et ses alliés, cette terre est considérée comme un “waqf”, une fondation pieuse, promise par Dieu, incessible », explique Henry Laurens.
Comment dépasser les tensions sans renier la foi ? Le rabbin français Philippe Haddad proposait en 2011, dans la revue Transversalités, de remplacer la notion de « Terre sainte » par celle de « Terre de sainteté », une terre sur laquelle les croyants « sont amenés à être saints », à « sanctifier la terre » par leur style de vie, aux côtés de ceux qui ne partagent pas leur vision. « Paradoxalement, dire qu’il s’agit de “la” Terre sainte, celle de tous les cultes, permettrait un dépassement des conflits par la religion en quelque sorte », complète Henry Laurens. Mais il nuance : « Je doute que cela soit possible, tant religieux et politique, sacré et nationalisme y sont liés. »